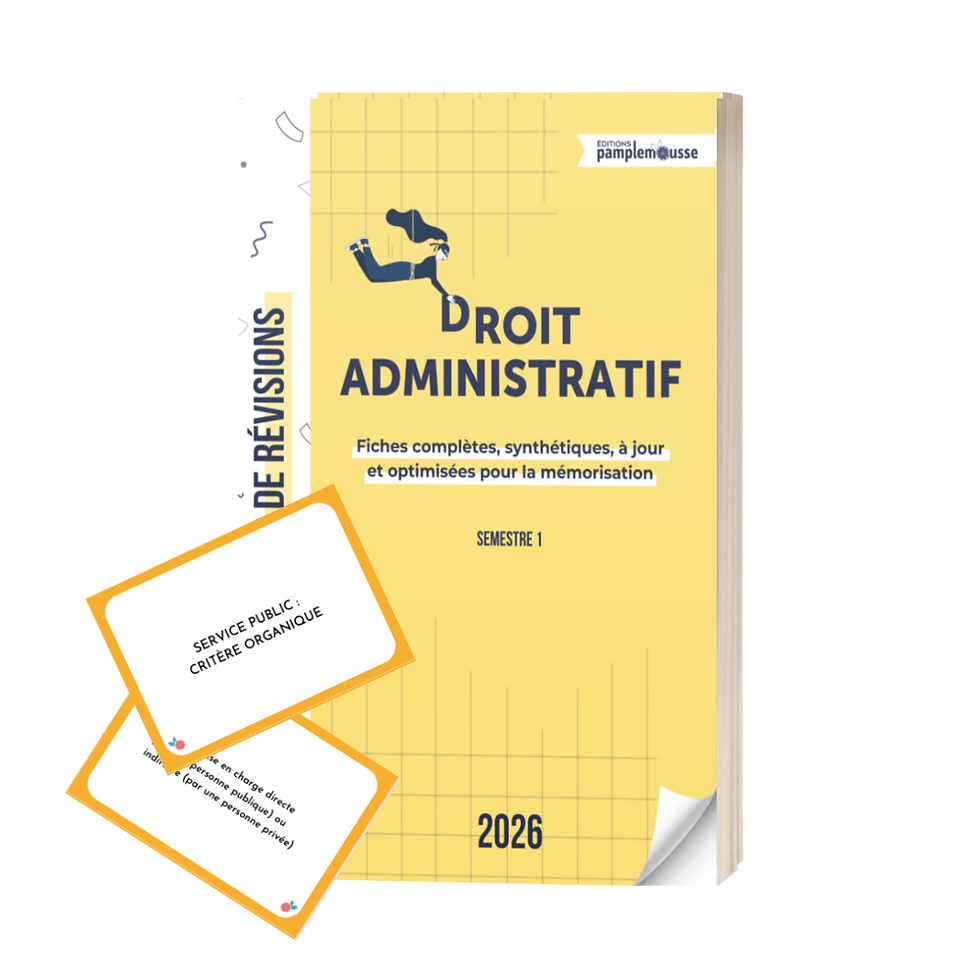Cours Droit des Sûretés
SOMMAIRE :
I. Les Fiches de droit et les Flashcards en Droit des Sûretés
II. C’est quoi le droit des sûretés ?
III. Le droit des sûretés en résumé
IV. Résumé du cours de Procédure pénale
V. Les notions étudiées en droit des sûretés
Découvrez toutes nos Flashcards de droit, un outil ludique et efficace pour maîtriser rapidement l'essentiel de chaque matière, toujours à jour et conçu par des experts.
II. C’est quoi le droit des sûretés ?
Le droit des sûretés est une branche du droit civil qui a pour objet les « sûretés ». Certains auteurs les qualifient de garanties, mais tous ne s’accordent pas, en doctrine, sur cette appellation.
Pour simplifier, retenez que les sûretés sont des garanties consenties à un créancier.
En revanche, si vos enseignants s’opposent fermement à qualifier une sûreté de garantie, ne mettez jamais cette phrase que l’on vient d’énoncer dans une copie !
a) Le droit des sûretés définition
Le droit des sûretés se définit comme le droit des « garanties » accordées par le contrat, le juge ou encore la loi, à un créancier pour recouvrer* sa créance.
*On écrit « recouvrer » et PAS « recouvrir ».
b) Quel est l’objet du droit des sûretés ?
L’objet du droit des sûretés est d’encadrer le droit des « garanties ». Les sûretés, quant à elles, sont mises en place afin d’assurer de meilleures chances de recouvrement aux créanciers. Autrement dit, elles ont pour objet de pallier l’insuffisance du droit de gage général.
En effet, le principe est que le patrimoine mobilier et immobilier est le gage commun des créanciers (art. 2284 du Code civil). Mais, pour s’assurer plus de possibilités d’être payés (cautionnement, garantie autonome ou encore lettre d’intention) ou encore une priorité de paiement (hypothèque, privilège), il existe les sûretés personnelles et les sûretés réelles (art. 2285 du Code civil).
En effet, le « droit de gage général » de l’article 2284 du Code civil est insuffisant, de même que les actions au bénéfice de tous les créanciers sous conditions (action oblique, action paulienne*) ou de certains d’entre eux (action directe*) peuvent ne pas suffire à désintéresser les créanciers. Ainsi, pour assurer ses arrières, il vaut mieux avoir des sûretés, tel est leur objet.
*Petit rappel de RGO à propos des actions oblique, paulienne et directe :
-
L’action oblique (art. 1341-1 du Code civil) permet à un créancier dont le débiteur est négligent et compromet ses droits d’agir auprès du débiteur de son débiteur pour sauvegarder les droits patrimoniaux de son débiteur (mais l’action profite à tous les créanciers, donc en définitive, s’il n’y a pas assez d’actif, les créanciers chirographaires risquent de rentrer bredouilles) ;
-
L’action paulienne (art. 1341-2 du Code civil) permet à un créancier d’agir pour rendre inopposable à son égard un acte de son débiteur réalisé en fraude ;
-
L’action directe (art. 1343-3 du Code civil) permet à un créancier d’agir directement contre le débiteur de son débiteur seulement dans les cas autorisés par la loi.
Pour résumer, cela signifie que tous les créanciers qui ne disposent d’aucune sûreté sont payés sur le patrimoine de leur débiteur, sans préférence (art. 2285 du Code civil). C’est ce qu’on appelle les créanciers chirographaires.
-
MAIS, il peut y avoir des créances assorties d’une sûreté qui donnent un droit de préférence (art. 2285 du Code civil). Cela permet aux créanciers qui en sont titulaires d’être payés par préférence sur le patrimoine du débiteur : ce sont les sûretés réelles.
-
Quant aux sûretés personnelles, elles ont pour objet l’engagement d’une autre personne en paiement.
c) Les différentes sûretés
Les sûretés peuvent être classées selon différentes manières :
-
les sûretés selon leurs sources;
-
les sûretés selon leurs objets.
Les différentes sûretés selon leurs sources
Les sûretés peuvent être établies par la loi (légales), par le contrat (conventionnelles) ou par le juge (judiciaires).
Les sûretés légales
Les sûretés légales sont celles établies par la loi, qui ont une origine légale. C’est le législateur qui estime que certains créanciers auront une sûreté, dans une situation spécifique.
Tel est le cas des privilèges qui sont des sûretés d’origine légale (art. 2331 s. du Code civil). Il existe, par exemple, le privilège du vendeur de fonds de commerce (art. L. 141-5 du Code de commerce).
Les sûretés conventionnelles
Les sûretés conventionnelles renvoient à celles établies par le contrat. Il peut s’agir d’une sûreté établie par le débiteur, comme une hypothèque ou un gage (sûreté réelle) ; ou une sûreté établie par un tiers au débiteur, comme une caution (sûreté personnelle).
Les sûretés judiciaires
Les sûretés sont judiciaires lorsqu’elles sont instituées par une décision de justice.
Les différentes sûretés selon leurs objets
Les sûretés peuvent être personnelles ou réelles (on vous explique !).
Les sûretés personnelles
Les sûretés personnelles sont celles consenties par une autre personne que le débiteur. Il s’agit d’un moyen qui permet au créancier d’ajouter un autre patrimoine que celui de son propre débiteur en garantie de sa dette. C’est un tiers qui s’engage à payer la dette d’une autre personne, si cette dernière est défaillante.
Tel est le cas d’un cautionnement (art. 2288 du Code civil).
Les sûretés réelles
Les sûretés réelles sont celles qui portent sur les biens du débiteur. Le créancier profite alors d’un droit préférentiel (art. 2323 du Code civil) sur tout ou partie du patrimoine de son débiteur (cela lui assure notamment une priorité de paiement).
Il existe par exemple le gage (art. 2333 s. et 2379 s. du Code civil), le nantissement (art. 2355 s. du Code civil) ou encore l’hypothèque (art. 2385 s. du Code civil).
Les sûretés réelles peuvent être mobilières ou immobilières. Les premières portent sur des meubles et les secondes sur des immeubles (art. 2324 al. 2 du Code civil).
III. Le droit des sûretés en résumé
Pour résumer le droit des sûretés, il est nécessaire d’évoquer ce qu’est le droit de gage général qui concerne les créanciers du débiteur.
a) Le droit de gage général
En droit des sûretés, vous entendrez parler notamment de créancier chirographaire et de créanciers privilégiés (au sens large). Les créanciers chirographaires ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (articles 2284 et 2285 du Code civil), tandis que les « créanciers privilégiés » ont un droit de préférence sur le patrimoine du débiteur (sûreté personnelle) ou un droit à l’égard d’un tiers (sûreté réelle).
Pour rappel, les créanciers chirographaires, c’est-à-dire, ceux sans aucune sûreté, bénéficient d’actions pour tenter de préserver leurs droits (action oblique, action paulienne, action directe). Néanmoins, ces actions peuvent ne pas suffire lorsque le débiteur se trouve en difficulté. Les derniers à être payés seront les créanciers chirographaires. C’est tout l’intérêt d’avoir une sûreté :
-
Demander à un tiers de payer lorsque son propre débiteur est insolvable (sûreté personnelle) ;
-
Profiter d’une priorité de paiement sur le patrimoine du débiteur (sûreté réelle).
b) Les sûretés
Parmi les sûretés, il existe les sûretés personnelles et les sûretés réelles.
Nous avons fait le choix de retenir ce découpage qui a l’avantage de la simplicité ! Allons-y pour une présentation résumée de ces mécanismes. Prenez bien des notes !
Les sûretés personnelles
Pour la énième fois (la répétition est la clé de l’apprentissage !), les sûretés personnelles sont celles consenties par une personne en garantie de la dette d’un tiers. Il existe différentes sûretés personnelles (art. 2287-1 du Code civil) :
-
le cautionnement ;
-
la garantie autonome ;
-
la lettre d’intention.
Par exemple, Tom achète une voiture à Charles. Ce dernier, compte tenu du prix, souhaite assurer ses arrières et demande à Tom une garantie. Ce dernier ne veut pas mettre ses biens en jeu et demande à sa compagne, qui gagne très bien sa vie, de se porter caution. Cette dernière accepte.
Dans notre cas, la compagne a consenti une sûreté personnelle, un cautionnement, au profit de la dette d’un tiers, celle de Tom.
Le cautionnement
Le cautionnement, en droit des sûretés, fait référence à un contrat qui manifeste l’accord exprès d’une personne qui s’engage à payer la dette d’un tiers s’il est insolvable (art. 2288 et 2294 du Code civil). Il peut être légal ou judiciaire (art. 2289 du Code civil).
Le régime du cautionnement est prévu aux articles 2288 s. du Code civil.
En cours de droit des sûretés, vous étudierez notamment les conditions de formation, les conditions de validité et les effets du cautionnement.
Vous verrez notamment qu’il peut être demandé par le débiteur, mais également souscrit à son insu.
💡Bon à savoir : en plus des conditions propres au cautionnement, étant donné qu’il s’agit d’un contrat, il faut remplir les conditions de l’article e1128 du Code civil (capacité des parties, consentement et contenu licite et certain). Il faut y penser pour toutes les sûretés qui sont consenties par engagement contractuel.
Vous apprendrez qu’il existe le bénéfice de division (diviser les poursuites entre le débiteur et la caution) sauf pour la caution solidaire (la solidarité implique que la caution puisse être poursuivie sans avoir à diviser les poursuites avec le débiteur). Il y a encore le bénéfice de discussion qui impose, pour le cautionnement simple, de poursuivre d’abord le débiteur principal, avant la caution simple (donc ce bénéfice ne profite pas à la caution solidaire).
Vous verrez même qu’il existe le « sous-cautionnement » à l’égard de la caution : payer à la caution ce que le débiteur lui doit. Il est aussi possible d’être la caution de la caution (donc à l’égard du créancier). Pour assurer ses arrières, c’est du solide !
Au terme de votre cours de droit des sûretés (rédigé dans un PDF bien organisé !), vous saurez tout des effets du cautionnement entre la caution et le créancier, entre la caution et le débiteur et, le cas échéant, entre les cautions.
Vous finirez cette partie sur les causes d’extinction du cautionnement.
La garantie autonome
La garantie à première demande est définie par l’article 2321 du Code civil comme l’engagement par lequel un garant s’oblige à verser une somme « à première demande » ou selon les modalités convenues en garantie de la dette d’un tiers.
Ce régime vous retiendra certainement moins longtemps et pour cause, même au sein du Code civil, il n’est l’objet que d’un seul article.
La lettre d’intention
L’article 2322 du Code civil définit la lettre d’intention comme l’engagement par lequel une personne s’oblige à faire ou à ne pas faire en soutien à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.
À nouveau, une personne s’engage au profit de la dette d’un tiers.
Les sûretés réelles
On vous le répète : les sûretés réelles sont celles qui portent sur les biens du débiteur. Le créancier profite d’un droit préférentiel (art. 2323 du Code civil) sur tout ou partie du patrimoine de son débiteur.
D’ailleurs, la partie du cours relative aux sûretés réelles vous retiendra certainement bien plus longtemps, tant elles sont plus nombreuses ! Nous distinguerons entre les sûretés réelles mobilières et les sûretés réelles immobilières.
💡 Bon à savoir : il existe l’agent de sûreté qui inscrit, gère, réalise des sûretés, en son nom propre, au profit des créanciers de l’obligation garantie (art. 2488-6 du Code civil).
Les sûretés réelles mobilières
Parmi les sûretés réelles mobilières, le Code civil distingue le gage, le nantissement et les privilèges mobiliers et la propriété cédée ou retenue à titre de garantie.
Le gage mobilier
Il existe le gage mobilier qui porte sur les meubles et le gage immobilier qui porte sur les immeubles. Le gage mobilier porte sur des meubles corporels, c’est-à-dire, tangibles : une voiture, une chaise ou un appareil photo.
Le régime du gage mobilier est prévu aux articles 2333 s. du Code civil.
Il s’agit d’un contrat donnant au créancier gagiste le droit de se faire payer par préférence sur un ou plusieurs biens meubles corporels de son débiteur.
En matière mobilière, vous verrez que le gage peut désormais être fait sans dépossession lorsqu’il porte sur des meubles. Néanmoins, s’il est fait avec dépossession, alors le créancier gagiste se voit remettre le bien.
Vous verrez notamment les conditions tenant au bien mis en gage, les conditions de formation d’un gage (et, comme c’est une convention, vous retrouverez l’article 1128 du Code civil !), et également les effets du gage qui varient dans le temps, en fonction de l’exigibilité de la créance.
Le nantissement
Le nantissement est une sûreté consentie sur un bien meuble incorporel comme un fonds de commerce. Il correspond à l’affectation en garantie d’un bien (ou d’un ensemble de biens) meuble incorporel. Le créancier qui en profite s’appelle le « créancier nanti ». Le nantissement est judiciaire ou conventionnel.
Le régime du nantissement est prévu aux articles 2355 s. du Code civil.
Vous apprendrez ses conditions de formation (s’il est contractuel, il doit notamment être conclu par écrit à peine de nullité et évidemment toujours respecter les conditions de validité du droit commun des contrats [art. 1128 C. civ.]).
Vous découvrirez également qu’il n’est opposable au débiteur de la créance nantie que s’il lui a été notifié et que ses effets diffèrent également selon la date d’exigibilité de la créance.
Les privilèges mobiliers
Les privilèges mobiliers sont ceux qui portent sur des meubles. Il s’agit d’une sûreté légale, c’est-à-dire, établie par la loi.
Le régime des privilèges est prévu aux articles 2330 s. du Code civil.
Vous apprendrez qu’ils sont généraux (portent sur tout le patrimoine du débiteur) ou spéciaux (portent sur des biens spécialement désignés, du débiteur).
Parmi les privilèges mobiliers (et immobiliers) généraux, vous trouverez par exemple le privilège des :
-
Frais de justice (art. 2331 et 2377, C. civ) ;
-
Salaires (art. 2331 et 2377, C. civ) ;
-
Procédures de difficulté des entreprises (art. L. 611-11, L. 622-17 et L. 643- 8 C. com).
Pour les privilèges mobiliers généraux, les créanciers privilégiés seront payés par préférence sur les biens du débiteur en général.
⚠️ Attention : vous verrez qu’il y a des ordres de préférence entre les créanciers privilégiés → en principe, les spéciaux priment, sauf pour les privilèges généraux des salaires, du Trésor public et des frais de justice.
Justement, il existe encore les privilèges mobiliers spéciaux du bailleur d’immeuble (sur les biens meubles qui garnissent le bien loué) ou du vendeur de fonds de commerce (sur le prix de vente du fonds de commerce, art. L. 141-5 du Code de commerce), par exemple.
Ce qu’il sera très important de comprendre (retenez bien ça !), c’est notamment l’articulation des différents privilèges entre eux :
-
quel ordre de préférence entre privilèges généraux ;
-
quel ordre de préférence entre privilèges spéciaux ;
-
quel ordre de préférence entre privilèges généraux et spéciaux (on y a légèrement répondu ci-dessus 🤭).
La propriété à titre de garantie
La propriété (peut être ❌) retenue (rétention) ou cédée à titre de garantie peut porter sur un bien meuble. Cela signifie que la propriété d’un meuble sera retenue OU transférée à titre de garantie d’une créance.
Le régime la propriété garantie est prévu aux articles 2367 s. du Code civil.
En ce qui concerne la propriété retenue, vous apprendrez, en cours de droit des sûretés, que la propriété-garantie suspend l’effet translatif du contrat de vente, par exemple, par l’intermédiaire d’une clause de réserve de propriété qui répond à des conditions spécifiques pour produire ses effets.
Il peut encore s’agir d’un contrat tout à fait spécifique de crédit-bail de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier.
Quant à la propriété cédée à titre de garantie, elle peut l’être par le mécanisme spécifique de la fiducie ou encore par la cession de créances ou de sommes d’argent.
Les sûretés réelles immobilières
Parmi les sûretés réelles immobilières, vous trouverez l’hypothèque, le gage immobilier, les privilèges immobiliers et la propriété (immobilière) à titre de garantie.
L’hypothèque
L’hypothèque correspond à l’affectation d’un bien immobilier en garantie. Le constituant n’est pas dépossédé de son bien, cela signifie que celui qui constitue l’hypothèque (constituant) n’est pas tenu de remettre son bien au créancier hypothécaire.
Le régime de l’hypothèque se trouve aux articles 2385 s. du Code civil.
L’hypothèque peut être consentie par contrat, prévue par la loi ou décidée par le juge (vous comprenez donc que l’hypothèque est conventionnelle, légale ou judiciaire).
En cours, vous allez probablement approfondir davantage l’hypothèque conventionnelle, en étudiant ses conditions de constitution (et comme tout contrat, vous reverrez 1128 du Code civil sur votre chemin), entre autres.
L’hypothèque est un contrat solennel, car il nécessite un écrit.
Vous apprendrez aussi que l’hypothèque est une sûreté indivisible, ce qui veut dire qu’elle concerne tout le bien affecté en garantie, mais qu’elle s’étend aux accessoires et améliorations de l’immeuble.
Vous verrez qu’elle impose une publicité : l’hypothèque doit être inscrite sur un registre spécial pour faire profiter, au créancier hypothécaire, d’un rang préférentiel de paiement. En effet, le rang dépend du moment où l’hypothèque est inscrite. Autrement dit, premier arrivé, premier servi ! Donc s’il y a plusieurs hypothèques consenties, mieux vaut ne pas traîner à la faire inscrire, bien qu’il n’y ait aucun délai qui soit imposé pour le faire. En revanche, l’inscription peut périmer (on parle de péremption de l’inscription, passé 50 ans par exemple). Elle peut encore être radiée (radiation) ou réduite (réduction de l’inscription).
Aussi, il faudra prêter attention aux situations qui paralysent l’inscription (si l’immeuble est vendu à un tiers, par exemple).
Lorsqu’une hypothèque est constituée, elle produit des effets ;
-
le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit de préférence (payé par préférence à d’autres créanciers, en fonction de son rang) et d’un droit de suite (peut suivre le bien en quelques mains qu’il se trouve → s’il est vendu, le créancier conserve son droit sur l’immeuble);
-
le constituant conserve son bien et peut même consentir d’autres hypothèques dessus, dès lors que le total n’excède pas la valeur de l’immeuble.
Dans le cas où le débiteur ne paierait pas, le créancier hypothécaire pourra se voir attribuer le bien ou se faire payer sur le prix de sa vente.
Et si le bien a été vendu à un tiers ? Ce dernier peut purger l’immeuble de l’hypothèque. La purge signifie que le tiers va donner le prix de l’hypothèque au créancier, par exemple.
La purge est d’ailleurs l’une des causes d’extinction d’une hypothèque à titre principal. Vous verrez qu’il y a d’autres causes d’extinction à titre principal ou accessoire.
Le gage immobilier
Le gage immobilier est aussi appelé antichrèse. Il s’agit d’affecter un bien immobilier en garantie, mais avec dépossession : le constituant est dépossédé de son immeuble.
Le régime du gage immobilier se trouve aux articles 2379 s. du Code civil.
Le gage immobilier emporte certains effets particuliers du fait de la dépossession, par exemple, le créancier a le droit de percevoir les fruits du bien immobilier. Il profite encore d’un droit de rétention sur l’immeuble.
Cette sûreté s’éteint si le débiteur paie sa dette : il récupère son bien. Elle peut également s’éteindre lorsque le débiteur ne paie pas : le créancier s’attribue le bien ou le fait vendre pour se payer sur le prix.
Les privilèges immobiliers
Les privilèges immobiliers sont aussi prévus par la loi.
Le régime des privilèges immobiliers se trouve aux articles 2379 s. du Code civil.
Contrairement aux privilèges mobiliers, les privilèges immobiliers sont toujours généraux. Ils confèrent un droit de préférence, mais pas de droit de suite, contrairement à l’hypothèque. On retrouve, par exemple, le privilège immobilier des frais de justice.
La propriété garantie
En matière immobilière, un propriétaire peut aussi céder sa propriété immobilière à titre de garantie en vertu d’un contrat de fiducie.
Le régime de la propriété garantie en matière immobilière se trouve aux articles 2488-1 s. du Code civil.
a) Les commentaires d'articles en Droit des Sûretés
IV. Tableau récapitulatif droit des sûretés
IV. Tableau récapitulatif droit des sûretés

V. Les notions étudiées en droit des sûretés
-
Droit de gage général
-
Créancier chirographaire
-
Créancier privilégié
-
Sûreté personnelle
-
Cautionnement
-
Garantie autonome
-
Lettre d’intention
-
Sûreté réelle
-
Sûreté réelle mobilière
-
Gage
-
Nantissement
-
Sûreté réelle immobilière
-
Hypothèque
VI. Comment apprendre le droit des sûretés ?
Pour bien apprendre le droit des sûretés, il est indispensable de bien comprendre la matière en général et spécifiquement l’articulation des sûretés entre elles. Pour y parvenir, le mieux est de schématiser tant que possible.
Comprendre l’intérêt de la mise en place de sûretés pour un créancier
L’intérêt de mettre en place des sûretés pour un créancier est de pallier la faiblesse du simple droit de gage général qui profite à tous les créanciers sans distinction. Il est donc primordial que vous compreniez cela pour bien saisir la matière.
S’il y a des sûretés, c’est parce qu’il y a nécessité de remplir ses obligations, mais le débiteur peut se révéler insolvable. Il convient donc d’assurer ses arrières avec des mécanismes qui offrent plus de possibilités d’être payé (sûretés personnelles) ou des priorités sur une partie ou l’intégralité du patrimoine (sûretés réelles).
Comprendre l’articulation des différentes sûretés entre elles
Chaque sûreté revêt des spécificités, il est indispensable de comprendre comment elles s’articulent, mais surtout l’ordre des privilèges en matière de sûretés réelles.
Réaliser des tableaux ou mindmaps pour schématiser les mécanismes
Le mieux pour apprendre le droit des sûretés est de réaliser des tableaux ou des mindmaps. La schématisation organisée des mécanismes vous permettra à votre tour d’organiser les informations dans votre esprit. Quoi de mieux, dans une matière dans laquelle il existe même un ordre de priorité de paiement ?
VII. Exemples d’exercices en droit des sûretés
Commentaire d’arrêt >

VIII. Les Flashcards en Droit des Sûretés
Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards droit des Sûretés sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit.
%20-%20Fiches%20de%20r%C3%A9visions%20Proc%C3%A9dure%20P%C3%A9nal%20-%20Pamplemousse%20Magazi.png)
%20-%20Fiches%20de%20r%C3%A9visions%20Proc%C3%A9dure%20P%C3%A9nal%20-%20Pamplemousse%20Magazi.png)
Les meilleurs outils pour réussir tes études de Droit
Valide et passe à l'année supérieure grâce aux Fiches de droit, Flashcards juridiques, Livres de droit.
La newsletter du bonheur ❤️
Rejoins les +15 000 inscrits !
Reçois gratuitement le ebook "9 lois du temps pour devenir un as de la productivité" et des conseils vitaminés (+ réductions...) pour réussir tes études de droit, avec le sourire !
(shots de motivation, réductions...)


![[COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)](https://static.wixstatic.com/media/03d090_18781e567ad14dff987cf9f7dbcdb556~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/03d090_18781e567ad14dff987cf9f7dbcdb556~mv2.webp)
![[COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)](https://static.wixstatic.com/media/03d090_18781e567ad14dff987cf9f7dbcdb556~mv2.png/v1/fill/w_313,h_235,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/03d090_18781e567ad14dff987cf9f7dbcdb556~mv2.webp)