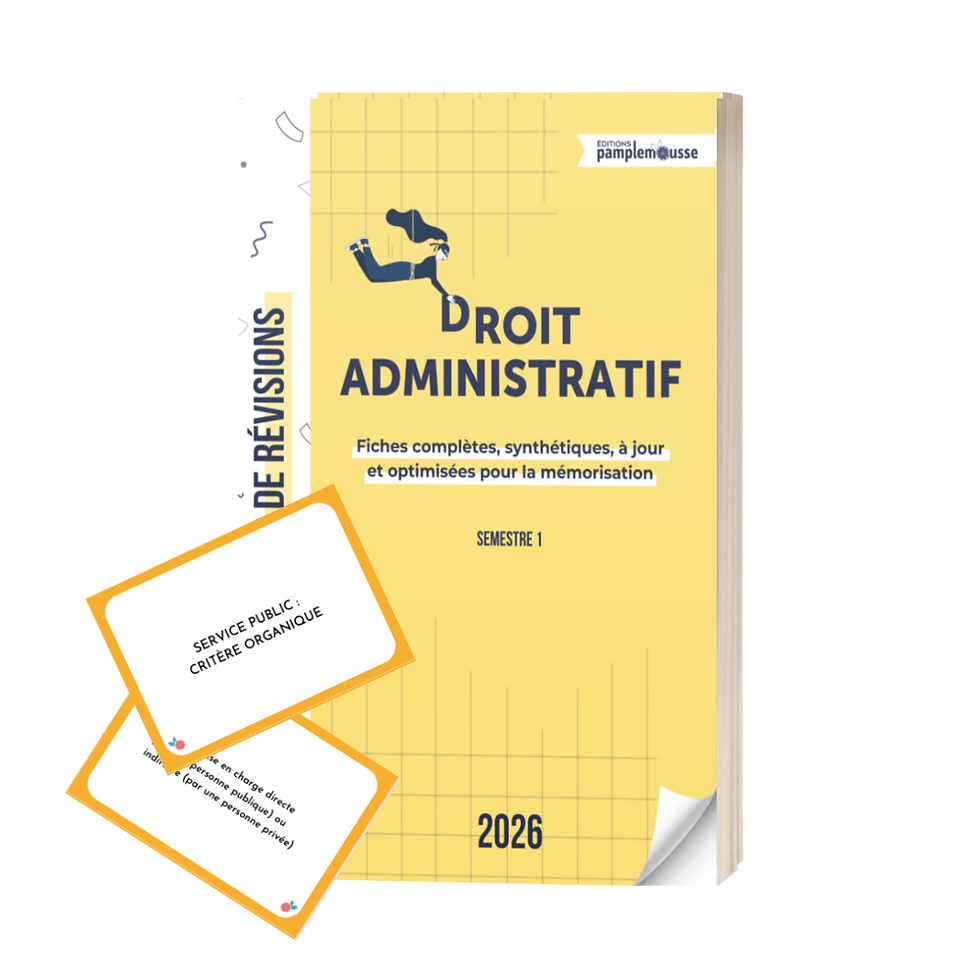Droit des contrats spéciaux
SOMMAIRE :
I. Les outils de révision en Droit des contrats spéciaux
II. Les cours en Droit des contrats spéciaux
III. Quelles sont les sources du Droit des contrats spéciaux ?
IV. Les exercices de contrats spéciaux
V. Quelle est la différence entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux ?
VI. Typologie des contrats spéciaux
VII. Les notions étudiées en cours de Droit des contrats spéciaux
VIII. Exemples de sujets d’examens
IX. 3 conseils pour apprendre le Droit des contrats spéciaux
I. Les Flashcards de droit en droit des contrats spéciaux
Découvrez toutes nos Flashcards de droit, un outil ludique et efficace pour maîtriser rapidement l'essentiel de chaque matière, toujours à jour et conçu par des experts.
II. C’est quoi le Droit des contrats spéciaux ?
Le droit des contrats spéciaux se définit comme un droit encadrant des contrats spécifiques, qu’il s’agisse de contrats civils ou commerciaux, par des mécanismes qui peuvent déroger au droit commun des contrats qui reste général.
Le droit des contrats spéciaux a pour objet l’étude de catégories de contrats particuliers comme : le contrat de vente, le contrat de bail, le contrat de prêt, le contrat d’entreprise, le contrat de dépôt, le mandat, la fiducie, l’échange et d’autres conventions très spécifiques comme l’arbitrage ou encore la transaction.
Définition du Droit des contrats spéciaux
Le droit des contrats spéciaux correspond aux règles qui encadrent des catégories spécifiques d’actes juridiques conventionnels. Il s’agit de contrats civils ou commerciaux qui relèvent d’un régime spécial (tu peux, par exemple, rencontrer le contrat de vente de fonds de commerce, qui est un contrat spécial qui relève du droit commercial).
Pour mieux comprendre cette définition, tu peux découper les éléments :
-
Droit → règles juridiques (on ne te refait pas le cours d’introduction générale au droit) ;
-
Contrats → accords de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101 du Code civil) ;
-
Spéciaux → spécifique à une matière.
Objet du Droit des contrats spéciaux
L’objet du droit des contrats spéciaux est… les contrats spéciaux (on enfonce des portes grandes ouvertes, n’est-ce pas ?). Tu vas t’amuser à analyser les régimes propres à chaque catégorie de contrat spécifique*.
*Contrat de vente, contrat de bail, contrat de dépôt, contrat de prêt, contrat d’entreprise, fiducie, ou encore échange, par exemple. Toutes ces conventions répondent à un régime propre.
Tu sais qu’il existe le droit commun des contrats, une matière fabuleuse aussi appelée « droit des obligations contractuelles ». Il s’agit du droit qui s’applique en principe à tous les contrats.
Le droit des contrats spéciaux vient préciser le régime de certains contrats spécifiques, voire déroger au droit commun. Et tu le sais, « specialia generalibus derogant » comme dirait Dumbledore ou un de tes enseignants de droit (c’est presque la même chose).
Cette incantation magique signifie que le spécial déroge au général. Autrement dit, lorsque des règles spéciales (ici notre droit des contrats spéciaux) sont édictées, elles dérogent aux règles générales (le droit commun des contrats).
Logique. Sinon, pourquoi, le législateur créerait-il des règles spécifiques ?
🎤 Témoignage de notre enseignante référente en Contrats spéciaux : « Je me souviens de cette matière, j’avais tellement aimé ! C’était une majeure à mon époque, autant dire qu’il fallait mettre le paquet. J’ai trouvé l’étude des catégories de contrats vraiment amusante, stimulante. La matière demandait beaucoup de rigueur et de minutie. Il fallait être en mesure d’établir des liens entre droit des obligations contractuelles et régimes spécifiques et surtout raisonner en n’oubliant aucun détail.
J’ai fini le partiel avec 19/20. L’enseignant a dit “19 en cas pratiques, je n’ai jamais vu ça”. J’étais fière de ma prouesse et aujourd’hui, pour que tu sois fier de toi aussi, je te donne quelques conseils au long de cet article . Ceux qui m’ont aidée à apprendre cette matière que je maîtrise encore aujourd’hui, près de 10 ans après et quelques réflexes de raisonnement à avoir pour des cas pratiques réussis à tous les coups (le 19 n’était pas exclusif à cette matière). »
III. Quelles sont les sources du Droit des contrats spéciaux ?
Les sources du droit des contrats spéciaux se trouvent majoritairement dans le Code civil (mais, évidemment, il y a des spécificités à aller trouver ailleurs, sinon ce serait trop simple, et en droit, simple n’existe pas).
De ce fait, la réforme du droit des contrats a affecté le régime général applicable à ces contrats spéciaux (parce que oui, Dumbledore « specialia generalibus derogant », mais specialia ne derogant pas aux règles impératives du droit des contrats qui s’imposent à tous, notamment en termes de validité des contrats [art. 1128 du Code civil]).
Les sources du Droit des contrats spéciaux
La majeure partie des sources du droit des contrats spéciaux figure dans le Code civil, aka votre meilleur allié depuis la L1. Il est rentable finalement (enfin, cela dépend des réformes* et on n’est jamais à l’abri).
*Une réforme du droit des contrats spéciaux était en discussion. Un avant-projet avait été présenté en juillet 2022. Pour l’instant, elle n’a pas été adoptée, mais, qui sait ?
Tu trouveras les dispositions relatives aux contrats spéciaux aux articles :
LA VENTE
L’ÉCHANGE
LE BAIL (APPELÉ « CONTRAT DE LOUAGE »)
💡Tu retrouveras les dispositions générales relatives au CONTRAT D’ENTREPRISE dans ce titre au chapitre III, relatif au louage d’ouvrage
LE PRÊT
LE DÉPÔT
LE MANDAT
LA FIDUCIE
(petite confession : pour ne rien simplifier, la fiducie peut être une sûreté, c’est-à-dire, une forme de garantie. Donc, parfois, tu la revois en droit des sûretés).
LA TRANSACTION
L’ARBITRAGE
Art. 1582 à 1701-1 du Code civil
Art. 1702 à 1707 du Code civil
Art. 1708 à 1831 du Code civil
Art. 1874 à 1914 du Code civil
Art. 1915 à 1953 du Code civil
Art. 1984 à 2010 du Code civil
Art. 2011 à 2030 du Code civil
Art. 2044 à 2052 du Code civil
Art. 2059 à 2061 du Code civil
Il y a des dispositions spécifiques dans des codes spéciaux comme le Code de commerce ou encore le Code de la consommation qui encadrent la vente.
Par exemple, le Code de la consommation interdit certaines ventes comme la vente à la « boule de neige » (art. L. 221-15 du Code de la consommation). Le Code de commerce réprime, quant à lui, la vente à perte (art. L. 442-5).
En matière de bail, c’est la même rengaine, tu as le régime général dans le Code civil (attends ?! Quoi ?) et tu découvres des régimes spéciaux à chaque type de baux : bail commercial (art. L. 145-1 et suivants du Code de commerce), bail d’habitation (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) ou encore bail rural (art. L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, oui, c’est un véritable code).
Si tu savais les codes qu’on a découverts lors de nos périples, du style « le Code des impositions sur les biens et services »…
Attends, on récapitule :
-
Le droit commun des contrats régit tous les contrats, quelle que soit leur forme ;
-
Le droit des contrats spéciaux est en fait un régime général pour des contrats spécifiques ;
-
Il existe ensuite une autre série de règles qui s’applique à des catégories précises de ces contrats spécifiques qui trouvent leurs sources dans d’autres textes codifiés ou non.
Donc, certes, tu es bien servi avec ton Code civil, mais n’oublie pas qu’il y a des droits encore plus spéciaux qui précisent ou dérogent à ces règles spécifiques.
Décidément, on n’en a plus fini avec notre « specialia generalibus derogant » si tout finit par déroger à tout !
Est-ce que le droit des contrats spéciaux a été impacté par la réforme ?
En lui-même, le droit des contrats spéciaux n’a pas été affecté par la réforme.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est venue réformer le droit des obligations et de la preuve, procédant, entre autres, à une renumérotation de nombreux articles du Code civil (et à la consécration de bon nombre de décisions jurisprudentielles).
Le droit commun des contrats a été complètement bouleversé. Naturellement, ces évolutions affectent le droit des contrats spéciaux, car, on te l’a dit, ces catégories de contrats restent soumises au droit commun. C’est en cela qu’ils sont concernés.
En revanche, la réforme du 10 février 2016 ne concernait pas les dispositions spécifiques qui n’ont pas été modifiées.
🍊 Petit conseil de notre enseignante : « J’ai réappris progressivement le droit des contrats lorsque j’ai commencé à l’enseigner. Tout ce que j’avais étudié à la fac a été réformé. Tous les articles que je connaissais avaient disparu. Ma vie a été chamboulée.
Mais, le droit, c’est avant tout avoir de bonnes bases et être en mesure de se réadapter face aux évolutions.
Alors, apprendre bêtement des numéros d’articles pendant des heures n’a aucun sens. Il vaut mieux comprendre le fonctionnement des mécanismes et heureusement, c’est ce que j’avais fait dès ma L2.
Certes, la « cause » a disparu (il ne faut pas m’enlever mes repères de cette façon, pour moi les conditions de validité, c'était « capacité, consentement, objet et cause » [ex. art. 1108 du Code civil] et pas « consentement, capacité, contenu licite et certain [art. 1128 du Code civil, on s’habitue à nos nouveaux compagnons]), mais pour autant, je sais toujours raisonner en ces termes.
Car elle demeure implicitement dans les textes au travers des idées de “buts” par exemple. Alors oui, bouleversement, mais sur le fond, si on sait raisonner, on se réhabitue très rapidement à l’évolution des concepts et des mécanismes. Commencez donc par comprendre si vous voulez de bonnes notes en cas pratiques ».

IV. Les exercices en droit des contrats spéciaux
a) Commentaires d'arrêts du droit des contrats spéciaux
V. Quelle est la différence entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux ?
Le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux se distinguent* du point de vue de leur champ d’application, des règles applicables, mais aussi de leurs objectifs respectifs.
*Parler de différence entre droit commun des contrats et droit des contrats spéciaux, peut être incohérent ou difficile, mais nous pouvons les distinguer l’un de l’autre.
Pour autant, le mieux est d’établir le lien qui regroupe ces deux matières pour raisonner comme il se doit et récupérer tous les points qui sont les vôtres en cas pratiques.
Quelques différences entre droit commun des contrats et droit des contrats spéciaux
Entre droit commun des contrats et droit des contrats spéciaux il existe plusieurs différences, notamment :
-
Des champs d’application différents ;
-
Des règles applicables différentes ;
-
Des objectifs différents.
Différence 1 : Des champs d’application différents
La première différence entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux est qu’ils ont des champs d’application différents.
En effet, les deux matières se distinguent : le droit commun des contrats s’applique à tous les contrats tandis que le droit des contrats spéciaux est cantonné par catégorie de contrats particuliers.
Ils sont tantôt soumis au Code civil, tantôt soumis à des lois ou des codes spécifiques. De quoi s’amuser à opérer des renvois.
🎤 Témoignage de notre enseignante référente en Contrats spéciaux : « La rigueur passe par l’utilisation des bons fondements juridiques.
C’est certainement ce qui a toujours fait la différence dans mes copies. Je n’écrivais jamais sans fondement, et parfois, il fallait aller chercher pour les obtenir, car les principes (ou exceptions) étaient établis par des textes spécifiques.
Si je n’avais pas de fondement juridique, je ne mettais simplement pas l’information. Il vaut mieux avoir une information 100 % certaine que faire du ”à peu près”. Si on n’est pas sûr, on ne parle pas. Ça devrait être la même chose dans les copies. »
Différence 2 : Les règles applicables
La deuxième différence entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux porte sur les règles applicables.
Le droit commun des contrats fixe les règles générales applicables à tous les contrats (art. 1101 à 1231-7 du Code civil). Ces règles sont, sauf exception*, supplétives, c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent que si les parties n’en ont pas convenu autrement.
Le droit des contrats spéciaux peut venir compléter ou modifier les règles du droit commun des contrats. Il peut également prévoir des règles dérogatoires, qui s’imposent aux parties.
*Les questions des conditions de validité s’imposent. Les parties ne peuvent pas déroger à ces règles en stipulant qu’en cas de violence morale, le contrat demeure valide.
Différence 3 : Des objectifs différents
Enfin, la troisième différence entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux est qu’ils ont des objectifs différents.
Le droit commun des contrats a pour objectif de protéger l’autonomie de la volonté des parties (cette liberté contractuelle, art. 1102 du Code civil).
Il permet aux parties de contracter librement, dans le respect de certaines limites, telles que l’interdiction des contrats contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 1162 du Code civil), ou la théorie des vices du consentement (art. 1130 s. du Code civil).
Le droit des contrats spéciaux a pour objectif de protéger les intérêts particuliers des parties à un contrat donné. Il peut ainsi prévoir des règles spécifiques pour protéger les consommateurs* ou encore les commerçants**.
Par exemple, le contrat de vente est un contrat nommé (art. 1105 du Code civil), qui est régi par le droit commun des contrats. Cependant, le Code de la consommation prévoit des règles spécifiques applicables aux contrats de vente entre un professionnel et un consommateur.
💡*Définis comme toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (art. liminaire du Code de la consommation).
💡**Toute personne qui réalise des actes de commerce (v. art. L. 110-1 s. du Code de commerce) de manière habituelle et indépendante (art. L. 121-1 du Code de commerce).
Quels sont les liens entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux ?
En réalité, le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux sont étroitement liés, puisque le second complète le premier en apportant un corps de règles adaptées à des opérations contractuelles spécifiques.
🍊 Petit conseil de notre enseignante : pour raisonner correctement, il faut d’abord voir le commencement de la relation contractuelle. Quelle que soit la catégorie de contrat, elle relève du droit commun.
On part d’abord des conditions de formation, mais elles peuvent être spécifiques à certains contrats. On garde en tête la base “un contrat est formé par l’échange des consentements” (art. 1113 du Code civil), et on va vérifier si pour chaque type de contrat, il n’y a pas de condition spécifique (remise de la chose, écrit à titre de validité, autre ?).
Ce sont notamment les conditions de validité qui sont communes à toutes les formes de contrat (art. 1128 du Code civil). Car les conditions de formation peuvent varier (un contrat réel n’est pas formé comme un contrat consensuel, et des conditions supplémentaires peuvent être requises). À ces conditions communes de validité, il faut ajouter les éléments propres aux régimes spécifiques qui s’imposent parfois. Il faut donc raisonner en deux temps pour la validité :
-
Droit commun → voir ce qui s’applique à tous sans exception ;
-
Droit spécial → ajouter les conditions spécifiques à la validité d’un contrat particulier.
Or, ce que mes camarades oubliaient, et c’est peut-être ce qui a fait la différence, c’est de procéder à ces étapes de base. Ils allaient directement sur le régime, sans même avoir qualifié la convention et vérifié qu’elle était formée de manière valide. »
VI. Typologie des contrats spéciaux
Le droit des contrats spéciaux traverse l’étude des contrats particuliers. Il existe plusieurs types de contrats spéciaux :
-
Certains ont pour objet de transférer la propriété d’un bien comme la vente, l’échange ou encore la fiducie ;
-
D’autres donnent un droit à user d’un bien comme le bail ou encore le prêt à usage ;
-
Certains ont pour finalité de servir l’autre partie comme le mandat, le contrat d’entreprise ou encore le contrat de dépôt ;
-
Tu rencontreras même certains contrats qui ont pour finalité de régler un litige comme la convention d’arbitrage* ou la transaction.
*Elle prend la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire (art. 1442 du Code civil), on y vient après.
⚠️ Attention : selon les enseignants, les classements des différents contrats seront différents et tu étudieras peut-être même d’autres variantes comme la location-vente, le crédit-bail, la donation ou encore certains contrats de distribution.
Aussi, garde à l’esprit qu’on fait du droit général des contrats spéciaux. Souviens-toi, on te l’a dit lorsqu’on évoquait Dumbledore : il y a du droit encore plus spécial pour chaque catégorie (donc, selon les affinités de tes enseignants, tu pourrais même finir par étudier le droit du bail commercial ou encore la location-gérance).
Les contrats transférant la propriété d’un bien
Les contrats transférant la propriété d’un bien d’un cocontractant à un autre sont le contrat de vente, l’échange et la fiducie.
Tu noteras que nous avons fait le choix discrétionnaire de classifier les contrats !
💡 On fera rapidement le tour des régimes. Si tu as besoin des fondements juridiques, on te renvoie à notre tableau qui répertorie les articles par catégorie. On ajoutera seulement les articles qui proviennent de sources extérieures aux dispositions spécifiques posées par le Code civil.
Le contrat de vente
Le contrat de vente est un acte juridique par lequel les parties s’accordent l’un à vendre, l’autre à payer. C’est un contrat translatif de propriété et à titre onéreux (contrairement à la donation, par exemple).
En droit des contrats spéciaux, tu étudieras la formation du contrat de vente en repassant par les avant-contrats que tu as déjà étudiés en droit commun des obligations.
Tu analyseras aussi les effets du contrat de vente et notamment les droits et obligations des parties.
La formation du contrat de vente
Tu verras les modalités de formation du contrat, les éléments de la vente, mais aussi les limites à la vente tenant aux parties ou à ses modalités.
➡️ Les éléments du contrat de vente :
Les éléments du contrat de vente sont la chose et le prix. Sans ces éléments, le contrat ne répond pas aux critères de la vente.
➡️ Les conditions de formation du contrat de vente :
Le contrat de vente doit respecter des conditions de forme (contrat consensuel) et de fond (conditions de validité, conditions relatives aux éléments essentiels).
Tout d’abord, la vente est – en principe – un contrat consensuel formé par le seul échange des consentements (art. 1113 du Code civil).
💡 Même la vente d’un immeuble n’impose, en principe, aucune forme (Cass. civ. 3, 27 nov. 1990, no 89-14.033). Fais attention à ce pour quoi tu donnes ton consentement, tu pourrais te retrouver avec des dettes astronomiques.
Néanmoins, on n’est jamais à l’abri d’un régime spécifique à une vente qui devrait, « ad validitatem » et pas juste « ad probationem » être formalisée par écrit (comme la vente d’un immeuble à construire, par exemple, art. L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation).
Ensuite, l’offre devra comporter les éléments essentiels (art. 1114 du Code civil), qui sont, en matière de vente, la chose et le prix.
Enfin, tu reparleras évidemment des conditions de validité (capacité, consentement, contenu licite et certain de l’article 1128 du Code civil).
En ce qui concerne le contenu, étant donné qu’il doit être déterminé ou déterminable (art. 1163 du Code civil), tu parleras de corps certains* et de choses de genre** (donc, si le droit des biens ou l’introduction générale au droit ne sont pas acquis, pense à les revoir).
💡*Les corps certains ne sont pas fongibles, c’est-à-dire, qu’on ne peut pas les remplacer, ils sont spécifiques. C’est le cas d'une œuvre d’art authentique, par exemple.
💡**Les choses de genre sont aussi dites « fongibles », c’est-à-dire, qu’elles sont remplaçables par des choses de même nature, poids ou qualité. Pour être vendues, elles doivent être individualisées (genre, 10 kilos de kiwis ou 100 kiwis à la pièce, tu payes rarement « des kiwis » en caisse. Ils sont individualisés).
Tu étudieras plus en détail qu’en L2, peut-être :
-
La promesse de vente (promesse unilatérale et promesse synallagmatique, avec le plaisir de discuter indemnités d’immobilisation et levée d’option) ; [Ndlr : voir un commentaire d’arrêt sur la promesse synallagmatique]
-
Le pacte de préférence (un avant-contrat fabuleux, si vous voulez notre avis). [Ndlr : voir des questions de cours sur les notions de promesse de vente et pacte de préférence].
➡️ Les limites à la vente
Il existe des limites à la liberté contractuelle de vendre ou ne pas vendre (art. 1102 du Code civil), relatives à la discrimination, à la préservation de la libre concurrence, à la capacité des parties, mais aussi à l’interdiction de certaines pratiques.
D’abord, le vendeur ne peut pas refuser de vendre pour des considérations qui seraient discriminatoires.
Ensuite, il peut arriver que le vendeur ait l’interdiction de vendre.
-
Le Code de la consommation interdit certaines pratiques afin de protéger le consommateur (v. art. L. 221-11 et suivants du Code de la consommation) ;
-
Le Code de commerce encadre ou interdit également certaines ventes dans le but de protéger le marché intérieur et préserver la libre concurrence (la vente à perte, art. L. 442-5 et la vente à un prix abusivement bas, art. L. 420-5 du Code de commerce).
Enfin, il ne faut pas oublier que la capacité des parties a son importance et qu’elle va parfois être un obstacle à la conclusion de certains contrats de vente.
Si l’enfant mineur est tout à fait en mesure d’aller acheter une baguette sur ses propres deniers, la vente deviendra plus délicate si son objet est une voiture de course (les mineurs ne peuvent passer que des actes de la vie courante, v. par exemple Cass. 1re civ., 9 mai 1972, N° 71-10.361).
Tu vois, il faut penser à tout.
Les effets du contrat de vente
La vente produit des effets entre les parties (eh oui, effet relatif des contrats, en principe).
L’effet principal est le transfert de propriété que tu étudieras aux côtés de la question du transfert des risques.
Tu verras aussi les obligations du vendeur et les obligations de l’acheteur successivement (ou pas).
➡️ Le transfert de propriété
Le contrat de vente a un effet translatif selon lequel lors de l’échange des consentements (en principe), l’acheteur devient propriétaire du bien (même s’il n’a pas payé le prix).
Néanmoins, tu verras qu’il est possible de faire entorse à ce principe en stipulant une clause de réserve de propriété, par exemple.
Et, parce qu’il faut toujours nuancer, tu aborderas la question du transfert des risques*, en principe, il suit le transfert de propriété, mais les parties sont libres de prévoir autre chose.
*La question à se poser est : qui supporte les risques qui pèsent sur la chose, lorsqu’ils surviennent ? En principe, le propriétaire (donc l’acheteur), sauf stipulation contraire.
➡️ Les obligations du vendeur
Le vendeur est tenu à plusieurs obligations, dont celle de délivrer la chose qui doit être conforme aux stipulations (on ne livre pas un centaure si on a vendu une licorne).
Aussi, le vendeur sera tenu à certaines garanties légales (prévues par la loi) ou contractuelles (prévues par le contrat).
-
Délivrance → mettre le bien à la disposition de l’acheteur.
⚠️ Attention : elle se distingue de l’obligation de livraison qui implique une remise matérielle de la chose à l’acheteur.
-
Conformité → le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, à sa fiche technique ou aux conditions générales de ventes (Cass. civ. 1, 1ᵉʳ décembre 1987, n° 85-12.046 ; Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-16.766 et Cass. com. 14 octobre 2008, n° 07-17.977).
L’obligation de conformité est étroitement liée à l’obligation de délivrance (Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 10-28.309).
💡On parle en réalité d’obligation de délivrance conforme, mais on a découpé pour que tu penses bien à raisonner sur tous les éléments.
⚠️ Attention : si le défaut de conformité qui affecte la chose en empêche l’utilisation normale, il devient un vice caché (Cass. civ. 1, 9 décembre 1993, n° 91-19.627) → « la chose est rendue impropre à l’usage auquel elle est destinée ».
-
Garantie → le vendeur est tenue à une obligation de :
-
garantie contre les vices cachés (cf. ci-dessus) ;
-
garantie d’éviction → il assure au possesseur la jouissance paisible de son bien contre les parasites qui souhaiteraient se l’approprier ;
-
garantie légale de conformité → on n’est pas sur la garantie de délivrance conforme prévue par le Code civil, mais une garantie légale prévue par le Code de la consommation qui impose la délivrance* (tiens donc) conforme au contrat et à des dispositions spécifiques (v. art. L. 217-3 du Code de la consommation).
*On souhaite protéger précisément le consommateur avec cette garantie plus précise que celle du Code civil. Et, tu le sais, le spécial déroge au général.
Cette garantie s’applique lorsque l’acheteur est un consommateur, c’est-à-dire, une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle (art. liminaire du Code de la consommation).
Première étape de raisonnement : vérifier la qualité des parties.
Chaque garantie vise à protéger l’acheteur de certaines situations. Tu auras le plaisir de les approfondir pendant le cours de droit des contrats spéciaux.
➡️ Les obligations de l’acheteur
L’acheteur a deux obligations : payer le prix et retirer la chose.
-
Payer le prix → selon les modalités prévues au contrat et, à défaut, selon les dispositions légales supplétives (les parties peuvent y déroger par le contrat), c’est-à-dire comptant et portable (au lieu de la délivrance).
L’acheteur doit donc payer le prix de la chose, mais aussi les éventuels frais.
-
Retirer la chose → l’acheteur doit venir prendre possession de la chose à l’endroit où elle se trouve lors de la délivrance, ce qui se situe généralement « chez » le vendeur (sauf si elle lui est livrée, cela va de soi)
L’échange
L’échange est le contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
On sera moins exhaustifs à propos de l’échange qui a un régime moins dense que la vente. Et pour cause, aujourd’hui, la vente est plus répandue.
Tu vas rarement faire l’acquisition d’un Code civil flambant neuf en échangeant ta collection inédite de surligneurs. Pour autant, l’échange figure toujours au sein du Code civil. N’as-tu pas déjà procédé à un échange lorsqu’un article n’allait pas ?
Tu verras qu’il y a quelques règles spécifiques à l’échange et que ce contrat a pour effet un double transfert de propriété.
La fiducie
La fiducie est le contrat par lequel la propriété de certains biens, droits ou sûretés (garanties) est transféré à un ou plusieurs fiduciaires qui agissent au profit d’un (ou plusieurs) bénéficiaire.
C’est une opération triangulaire qui fait intervenir trois protagonistes.
Les fiduciaires doivent tenir l’objet du contrat séparé de leur patrimoine personnel.
Le but de l’opération est déterminé par le contrat de fiducie* (et c’est là que tu retrouves la « fiducie-sûreté » que tu étudies, en principe, en droit des sûretés).
💡*Il existe la fiducie-transmission, la fiducie-sûreté, la fiducie gestion et une fiducie spécifique au droit des assurances (encore des spécificités, décidément !).
Tu étudieras son formalisme rigoureux et ses effets. C’est notamment un contrat solennel qui impose un écrit à peine de nullité (eh oui, il y a des mentions obligatoires et il doit être exprès).
Le contrat assurant la conservation d’un bien : le dépôt
Le contrat de dépôt est celui par lequel une personne (déposant) met un bien à disposition d’une personne (dépositaire) qui est chargée de la conserver. C’est un contrat réel, c’est-à-dire, formé par la remise de la chose (art. 1109 du Code civil).
Il y a un régime particulier, notamment relatif à la conservation de la chose (et donc la possibilité d’en user ou non, que tu auras la joie de découvrir en cours magistral de droit des contrats spéciaux).
Les contrats conférant l’usage d’un bien
D’autres contrats comme le bail ou encore le prêt confèrent à leur titulaire la possibilité d’user d’un bien. Tu développeras leur régime général, et peut-être les régimes spécifiques à chaque catégorie (car, il existe une infinité de baux, et une infinité de contrats de prêt).
Le contrat de bail
Le contrat de bail est celui par lequel un propriétaire (bailleur) met à disposition d’un locataire (preneur*) l’usage de son bien. Il fait référence au contrat de « louage de chose » si l’on s’en tient au Code civil.
📚 *Peut-être que tu fais partie de ceux qui ne distinguent pas bailleur et preneur ? Notre enseignante nous a dit qu’à l’époque, elle se disait que le preneur est « celui qui prend » le bail. Le bailleur, c’est l’auteur du bail, donc forcément celui qui met à la chose à disposition.
Tu étudieras le droit commun du bail : son objet, ses conditions de formation et ses effets. Et si tes enseignants sont friands de cette convention, tu verras peut-être des contrats spécifiques comme le bail commercial, le bail d’habitation, la location-gérance, le bail rural, etc.
L’objet du contrat de bail
Le bail, quel que soit son régime, a pour objet de mettre à disposition la jouissance d’un bien à un preneur, en contrepartie d’un prix (loyer), pendant une certaine durée*.
💡 *On revient sur le droit commun des contrats : le bail est un contrat à exécution successive, c’est-à-dire, dont l’exécution est échelonnée dans le temps (art. 1111-1 du Code civil).
Ainsi, s’il y a un problème dans l’exécution, tu dois parler de résiliation et pas de résolution (art. 1224 et s. du Code civil) pour anéantir le contrat.
L’utilisation des bons termes avec minutie traduit une bonne maîtrise des régimes, nous indique notre enseignante.
La formation du contrat de bail
La formation du contrat de bail répond aux conditions du droit commun des contrats (art. 1128 du Code civil) et les éléments essentiels à déterminer sont la chose et le prix du loyer.
💡 En principe, la conclusion d’un contrat de bail n’est pas soumise à un formalisme particulier, mais parfois, elle va imposer un écrit comme pour un bail d’habitation (art. 3 de la loi du 6 juillet 1989).
Tu verras que le bail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée (et le bail sans écrit est, selon le Code civil, à durée indéterminée. Logique…).
Les effets du contrat de bail
Le bail a pour effets principaux d’imposer la mise à disposition d’un bien par le bailleur au preneur qui doit en payer le prix (loyer). Chaque partie a des obligations réciproques (contrat synallagmatique, art. 1106 du Code civil).
➡️ Les obligations du bailleur
Le bailleur est tenu à une obligation de :
-
Délivrance → mise à disposition de la chose louée ;
-
D’entretien → mais tu distingueras entre les obligations d’entretien du bailleur et ceux du preneur (« petites réparations ») ;
-
De garantie → vices cachés, d’éviction (appelée « garantie de jouissance paisible »).
➡️ Les obligations du preneur
Le preneur a une obligation principale qui est celle de payer le prix. Mais il est également tenu de :
-
Faire usage de la chose raisonnablement (éviter de la détériorer ou de la détourner de la destination pour laquelle elle a été louée) ;
-
Conserver la chose pour la restituer.
Tu verras également que le bail peut circuler (changement de bailleur, sous-location) et s’éteindre.
Le contrat de prêt
Le prêt est le contrat par lequel une partie met à disposition d’une autre un bien dont l’emprunteur peut faire usage, en imposant sa restitution en nature ou en valeur*, avec ou sans intérêts.
Tu verras peut-être plus précisément le prêt à usage (ou commodat), le prêt à la consommation ou encore le prêt d’argent.
*De ce fait, on distingue, selon l’héritage du droit romain, le commodat du mutuum. Le premier est un prêt qui autorise l’usage de la chose prêtée qui devra, à terme, être restituée.
Le second, aujourd’hui appelé prêt à la consommation, fait référence à la possibilité d’user de la chose prêtée qui sera détruite par l’usage. Il est impossible de la restituer.
Le prêt à usage ou commodat
Le prêt à usage est le contrat par lequel le prêteur met à disposition l’usage d’une chose à un emprunteur tenu de la lui restituer*.
*De ce fait, naturellement le prêt à usage ne peut pas porter sur une chose consomptible, c’est-à-dire, qui disparaît dès son usage (revois vraiment la classification des biens, ça te sera très utile).
Tu ne peux donc pas prêter tes 10 kilos de kiwis à ton camarade, car il va les consommer (oui, oui, c’est faisable), et ne te les restitueras pas. En revanche, tu peux lui prêter ton Code civil, il y a peu de chance qu’il le mange.
💡 Comme, à ses origines, ce mécanisme correspondait à un « prêt d’ami », il était essentiellement à titre gratuit (eh oui, ça existe, les gens désintéressés).
Tu analyseras les règles de formation (spoiler, on retombe sur le droit commun des contrats, même si les auteurs parlent de « contrat réel », c’est-à-dire, traditionnellement formé par la remise de la chose, ce qui ne ressort pas directement de l’article 1875 du Code civil) et les effets d’un tel contrat.
On te laisse le plaisir de le découvrir en cours de droit des contrats spéciaux.
Le prêt à la consommation
Le prêt à la consommation est celui par lequel une quantité de choses consomptibles (qui se consomment) sont mises à disposition d’un emprunteur qui devra en rendre la même quantité et la même espèce.
Là, tu peux prêter tes 10 kilos de kiwis. Une fois que ton ami aura fait le plein de vitamines C, il devra t’en restituer la même quantité et la même espèce.
Donc, s’il revient avec des oranges, tu lui diras que la teneur en vitamines C n’est pas la même. À la limite, il aurait mieux fait de t’apporter des brocolis, c’est plus riche que les kiwis en vitamines C, pas les oranges !
Quant aux conditions de formation, on retombe sur le droit commun des contrats.
Le prêt d’argent
Le prêt d’argent est une forme de prêt à la consommation qui porte sur une somme d’argent. Il est soumis à un formalisme plus rigoureux selon la qualité des parties.
Les contrats portant sur les services
Il existe encore le contrat de mandat ou le contrat d’entreprise qui portent sur la réalisation d’un « service ». Tu en étudieras la formation (en principe, consensuelle) et les effets.
Le contrat de mandat
Le contrat de mandat se définit comme un contrat de représentation : le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant afin de réaliser une opération (conclure un acte, par exemple).
Tu verras qu’il est distinct d’autres contrats spécifiques comme un contrat de travail qui impose notamment un lien de subordination et une rémunération (v. Cass. soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187).
Classiquement, tu verras ses conditions de formation (on t’a dit, en principe, consensuelles) et ses effets.
Le contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est celui par lequel une personne indépendante réalise une prestation au profit d’une autre, moyennant rémunération. Il fait référence au « louage d’ouvrage » dans le Code civil.
Tu verras son régime général (formation, effets) et peut-être les particularités de certains contrats d’entreprise.
💡 Il se distingue du contrat de travail, car le prestataire n’est pas subordonné à son client pour lequel il réalise une prestation.
Néanmoins, tu dois faire attention, car tu peux avoir des situations alambiquées et il est difficile de qualifier le contrat : entreprise ? Vente ?
La jurisprudence indique que « le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé juridiquement comme une vente dès lors que le travail en constitue l’accessoire » (Cass. civ. 1, 27 avril 1976, n° 74-14.436).
Les contrats portant sur le règlement des litiges
Peut-être que tu auras l’occasion d’étudier les contrats qui aboutissent à régler des litiges sans passer par la juridiction étatique : la transaction et l’arbitrage.
La transaction
La transaction est la convention par laquelle les parties font des concessions réciproques pour régler une contestation née ou prévenir une contestation à naître.
Ce contrat impose un écrit. Tu verras qu’il faut remplir les conditions du droit commun, mais qu’il y a des matières sur lesquelles il n’est pas possible de transiger (comme l’intérêt civil qui résulte d’un délit).
Tu apprendras également que lorsqu’une transaction a été réalisée, il n’est plus possible de soumettre le litige à un juge pour le même objet.
L’arbitrage
L’arbitrage est un mode de règlement des litiges alternatif à la juridiction étatique. Il peut prendre la forme d’un compromis d’arbitrage* ou d’une clause compromissoire** (art. 1442 du Code de procédure civile).
*Le compromis d’arbitrage est conclu lorsque le litige est né. Les parties décident de le soumettre à l’arbitrage.
**La clause compromissoire est insérée dans un contrat avant la naissance d’un litige. Les parties anticipent en choisissant de soumettre leurs potentiels différends à un arbitre.
Tu verras que la convention d’arbitrage (l’une ou l’autre des formes) impose un écrit, mais que la clause compromissoire répond à certaines spécificités. Dans les deux cas, l’arbitrage ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition, c’est-à-dire :
-
Il est impossible lorsque des droits extrapatrimoniaux sont en cause (droit à l’image, protection de la vie privée, etc.), puisque ce sont des droits dont on ne peut disposer ;
-
Il est expressément interdit pour certaines matières (capacité, divorce, filiation, etc.).
Le compromis d’arbitrage
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou de plusieurs personnes (art. 1442 du Code de procédure civile).
💡 Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction (art. 1446 du Code de procédure civile).
Tu découvriras les règles de forme du compromis d’arbitrage :
-
Un document écrit (art. 1443 du Code de procédure civile) ;
-
La précision de l’objet du litige (art. 1445 du CPC, Cass. civ. 2, 23 septembre 1998, n° 96-22.526) ;
-
L’affirmation de volonté de faire juger le litige par les arbitres (Cass. civ. 2, 7 novembre 1974).
💡 Le compromis est soumis aux conditions qui régissent les contrats en général (art. 1128 du Code civil).
Il exige par conséquent le consentement des parties, leur capacité de s’obliger, un contenu licite et certain. Le compromis serait nul si le consentement des parties avait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence (Cass. civ. 2, 13 avril 1972).
La clause compromissoire
Il s’agit d’une clause insérée dans un contrat bien avant la naissance d’un litige. Il s’agit d’anticiper la survenance d’un litige qui sera, le cas échéant, soumis à l’arbitrage (art. 1442 du Code de procédure civile).
Cas dans lesquels la clause compromissoire est autorisée :
-
La clause compromissoire est tout d’abord permise en droit commercial (art. L. 721-2 et L. 411-4 du Code de commerce).
Depuis 2001, cette faculté a été élargie plus largement entre tous professionnels → elle est valable lorsqu’elle est conclue à raison d’une activité professionnelle (art. 2061 du Code civil). Deux conditions sont exigées :
-
La clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée (sauf succession de contrat) ;
-
La clause doit être stipulée entre professionnels, sinon elle est inopposable à celui qui n’est pas professionnel.
Tu verras quelques règles de forme. La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être écrite.
Elle peut résulter d’un échange d’écrits entre les parties ou d’un document (conditions générales de vente ou d’achat, contrat type, règles et usages d’un commerce déterminé…) auquel il est fait référence dans la convention principale (art. 1443 du CPC).
La clause compromissoire peut désigner les arbitres, mais, le plus souvent, elle prévoit les modalités de leur désignation (art. 1444 du CPC).
Liste des contrats spéciaux
Pour résumer, voici la liste des contrats spéciaux (précision : certains relèvent d’autres matières, comme le droit de la consommation, donc nous avons fait le choix de ne pas les développer ici).
-
Le contrat de vente (vente internationale, vente de fonds de commerce) ;
-
Les contrats de distribution ;
-
L’échange ;
-
La donation ;
-
La fiducie ;
-
Le contrat de dépôt ;
-
Le contrat de bail (bail de droit commun, bail d’habitation, bail commercial, bail rural, location-gérance) ;
-
Le contrat de prêt (contrat de prêt à usage, contrat de prêt à la consommation, contrat de prêt d’argent) ;
-
Le crédit à la consommation ;
-
Le crédit immobilier ;
-
Le contrat de mandat (mandat de droit commun, mandat d’intérêt commun, mandat des professions réglementées, mandat posthume) ;
-
Le contrat d’entreprise ;
-
Le contrat de sous-traitance ;
-
Les contrats de construction ;
-
Le contrat de transport ;
-
La transaction ;
-
L’arbitrage (compromis d’arbitrage, clause compromissoire) ;
-
Le contrat d’assurance.
VII. Les notions étudiées en cours de Droit des contrats spéciaux
-
La vente ;
-
La vente : conditions de forme ;
-
La vente : conditions de fond, capacité ;
-
La vente : conditions de fond, chose ;
-
La vente : conditions de fond, chose, inaliénabilité légale ;
-
La vente : conditions de fond, chose, inaliénabilité conventionnelle ;
-
La vente : conditions de fond, chose, inaliénabilité judiciaire ;
-
La vente : ventes interdites, protection consommateur ;
-
La vente : ventes interdites, protection libre-concurrence ;
-
La vente : les droits d’acquisition préférentielle, droit de préemption ;
-
La vente : les droits d’acquisition préférentielle, pacte de préférence ; [Ndlr : voir un commentaire d’arrêt sur le pacte de préférence]
-
La vente : le refus de vente ;
-
La vente : avant-contrat, la promesse unilatérale ;
-
La vente : avant-contrat, la promesse unilatérale, conditions de forme ;
-
La vente : avant-contrat, la promesse unilatérale, révocation ;
-
La vente : avant-contrat, la promesse synallagmatique de vente ;
-
L’objet de la vente ;
-
L’objet de la vente : une chose existante périe ;
-
L’objet de la vente : une chose future ;
-
L’objet de la vente : une chose appropriée ;
-
L’objet de la vente : une chose aliénable ;
-
L’objet de la vente : une chose déterminée ou déterminable ;
-
Le prix ;
-
Le caractère déterminable du prix ;
-
Le caractère réel du prix ;
-
Le caractère lésionnaire du prix ;
-
Le caractère lésionnaire du prix : la rescision pour lésion ;
-
Le consentement : principe ;
-
Le consentement : obligation d’information (1/3) ;
-
Le consentement : obligation d’information (2/3) ;
-
Le consentement : obligation d’information (3/3) ;
-
L’aménagement de la réflexion : délai de réflexion ;
-
L’aménagement de la réflexion : délai de rétractation ;
-
La vente : conditions de forme, contrats spécifiques ;
-
Les effets de la vente : transfert de propriété ;
-
Les effets de la vente : transfert de propriété, exceptions ;
-
Les effets de la vente : transfert des risques ;
-
Les effets de la vente : transfert des risques, exceptions (1/2) ;
-
Les effets de la vente : transfert des risques, exceptions (2/2) ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance, formes ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance, lieu ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance, délai ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance, étendue ;
-
Les effets de la vente : obligation de délivrance, sanctions ;
-
Les effets de la vente : garantie d’éviction ;
-
Les effets de la vente : garantie d’éviction, conséquences ;
-
Les effets de la vente : garantie des vices cachés, conditions ;
-
Les effets de la vente : garantie des vices cachés, conséquences ;
-
Les effets de la vente : obligation de paiement ;
-
Les effets de la vente : obligation de retrait ;
-
L’échange ;
-
L’échange : dispositions spécifiques ;
-
La fiducie ;
-
La fiducie : formation, conditions de fond, biens ;
-
La fiducie : formation, conditions de fond, personnes ;
-
La fiducie : formation, conditions de forme ;
-
La fiducie : formation, conditions de forme, mentions obligatoires ;
-
La fiducie : effet réel ;
-
La fiducie : effet obligationnel : extinction ;
-
Le bail ;
-
L'objet du bail ;
-
La durée du bail ;
-
Le prix du bail ;
-
Le bail : conditions de forme ;
-
Les effets du bail : obligation de délivrance ;
-
Les effets du bail : obligation d’entretien ;
-
Les effets du bail : garantie d’éviction ;
-
Les effets du bail : garantie des vices cachés ;
-
Les effets du bail : obligation de payer ;
-
Les effets du bail : obligation d’user de la chose ;
-
Les effets du bail : obligation de conserver la chose ;
-
Les effets du bail : obligation de restituer la chose ;
-
L'extinction du bail ;
-
Prêt à usage ;
-
Les effets du prêt à usage ;
-
Prêt à la consommation ;
-
Les effets du prêt de consommation ;
-
Le mandat ;
-
Le mandat : conditions de fond, capacité ;
-
Le mandat : conditions de fond, missions ;
-
Le mandat : conditions de fond, prix ;
-
Le mandat : conditions de forme ;
-
Le mandat : conditions de forme, caractère tacite ;
-
Le mandat : effets, obligation d’exécution ;
-
Le mandat : effets, obligation de reddition des comptes ;
-
Le mandat : effets, obligation de coopération ;
-
Le mandat : effets, obligation de rémunération ;
-
Le mandat : effets, obligation d’indemnisation des frais et pertes ;
-
Le mandat : effets à l’égard des tiers, mandataire ;
-
Le mandat : effets à l’égard des tiers, mandant ;
-
L'extinction du mandat ;
-
Contrat d'entreprise ;
-
Contrat d'entreprise : fixation du prix ;
-
Contrat d'entreprise : fixation du prix, clauses ;
-
Contrat d'entreprise : effets, transfert de propriété ;
-
Contrat d'entreprise : effets, transfert des risques ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation d’exécution ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation d’information ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation de sécurité ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation de paiement ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation de coopération ;
-
Contrat d'entreprise : effets, obligation de réception ;
-
L'extinction du contrat d'entreprise ;
-
Le dépôt ;
-
Le dépôt : conditions de fond, capacité ;
-
Le dépôt : conditions de fond, consentement ;
-
Le dépôt : conditions de forme ;
-
Le dépôt : prix ;
-
Le dépôt : effets, obligation de conservation ;
-
Le dépôt : effets, obligation de restitution ;
-
Le dépôt : effets, obligation de remboursement ;
-
L'extinction du dépôt ;
-
La transaction ;
-
La transaction : conditions de formation ;
-
Les effets de la transaction ;
-
L’arbitrage ;
-
L’arbitrage : modalités ;
-
L’arbitrage : conditions de formation.
VIII. Exemples de sujets d’examens
Exemples de sujets de dissertation en Droit des contrats spéciaux
-
L’effet de la digitalisation sur la formation et l’exécution du contrat de vente ;
-
L’obligation de délivrance conforme ;
-
La lésion en matière de vente ;
-
La protection du consommateur dans le contrat de vente ;
-
La force majeure et le dépôt ;
-
Les clauses abusives dans les contrats de bail ;
-
La place de la bonne foi dans la conclusion et l’exécution du contrat de prêt ;
-
La responsabilité des parties au contrat d’entreprise ;
-
Les évolutions législatives du droit des contrats spéciaux ;
-
La protection des droits du bailleur et du locataire dans le contrat de bail commercial.
IX. 3 conseils pour apprendre le Droit des contrats spéciaux
Voici 3 conseils pour apprendre efficacement le droit des contrats spéciaux.
Conseil 1 : Apprendre le plan du cours
Apprendre (et surtout, comprendre !) le plan du cours de Droit des contrats spéciaux est essentiel, car cela te permet de visualiser la structure du cours et saisir la réflexion de ton enseignant.
En effet, en connaissant le plan, tu sauras quels sont les sujets abordés, dans quel ordre et comment ils se connectent les uns aux autres. Eh oui, si ton enseignant fait passer un élément avant un autre dans le cours, cela a forcément un sens !
Cette compréhension t’aidera donc à mieux assimiler les informations, à organiser tes notes de manière logique et à anticiper les futurs développements du cours.
Pour apprendre le plan, va du général au particulier : d’abord les parties, puis les chapitres, puis les sections, etc.
Conseil 2 : Maîtriser ses bases (droit des contrats, droit des biens)
Maîtriser les bases de tes cours de droit des contrats et de droit des biens est indispensable, car le droit des contrats spéciaux repose sur des concepts et des principes issus de ces deux matières.
Par conséquent, avoir une maîtrise solide de ces domaines fondamentaux est essentiel pour une compréhension approfondie des contrats spéciaux.
Si tes bases dans ces domaines sont faibles, il sera difficile de saisir pleinement les subtilités et les nuances des contrats spéciaux… Comme toujours, on ne construit pas une maison sans fondations.
Révise donc les définitions, les principes fondamentaux et les types de contrats et de biens. Tu ne passes pas aux contrats spéciaux sans maîtriser tout ça, deal ?
Conseil 3 : S’exercer à qualifier les situations
Qualifier une situation juridique consiste à identifier les éléments pertinents d'un cas donné, à les analyser à la lumière du vocabulaire juridique et des règles juridiques applicables, et à en tirer des conclusions juridiques pertinentes.
Tu sais ce que cela signifie ? Si tu qualifies mal tes situations, tu vas appliquer les mauvais régimes juridiques… Plutôt problématique, n’est-ce pas ?
Donc si tu veux résoudre tes cas pratiques et appliquer le droit de manière efficace dans la pratique professionnelle, il faut absolument que tu t’entraines jusqu’à maîtriser la qualification juridique !
Pour cela, pas de secrets : des exercices réguliers, encore et toujours, avec, si possible, des retours de tes enseignants. Si jamais tu n’as pas beaucoup de commentaires sur tes copies, sache qu’il y a des copies annotées sur notre site !
X. Les Flashcards du Droit des contrats spéciaux
Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards en droit des contrats spéciaux sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit.


Télécharge maintenant ton extrait gratuit Flashcards du Droit des Contrats Spéciaux (PDF)
Les meilleurs outils pour réussir tes études de Droit
Valide et passe à l'année supérieure grâce aux Fiches de Droit, Flashcards, Guides de réussite
La newsletter du bonheur ❤️
Rejoins les +15 000 inscrits !
Reçois gratuitement le ebook "9 lois du temps pour devenir un as de la productivité" et des conseils vitaminés (+ réductions...) pour réussir tes études de droit, avec le sourire !
(shots de motivation, réductions...)







![[QUESTIONS DE COURS] Sujet : Cass. 3ᵉ civ., 25 mars 2009 (Contrats spéciaux)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_f875c7b03c514281b92a1a1d2a5b8e7b~mv2.jpg/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/415bfa_f875c7b03c514281b92a1a1d2a5b8e7b~mv2.webp)
![[QUESTIONS DE COURS] Sujet : Cass. 3ᵉ civ., 25 mars 2009 (Contrats spéciaux)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_f875c7b03c514281b92a1a1d2a5b8e7b~mv2.jpg/v1/fill/w_306,h_230,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/415bfa_f875c7b03c514281b92a1a1d2a5b8e7b~mv2.webp)